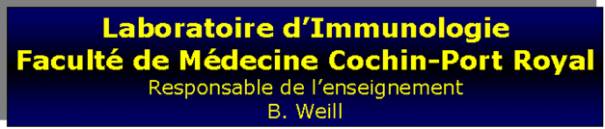Chapitre 22
TRAITEMENTS IMMUNOLOGIQUES
I- Sérothérapie et vaccination
A
- Sérothérapie:
Il s'agit d'une immunothérapie passive. Les anticorps transmis passivement sont des immunoglobulines sériques provenant d'un autre organisme immunisé activement ou spontanément. L'avantage de ce type d'immunothérapie est la possibilité d'agir vite, en apportant au moment opportun les éléments de défense sérique dont le sujet a besoin, sans tenir compte du délai nécessaire pour l'apparition d'ue réaction immunitaire efficace. En contre partie, l'effet ne dure qu'autant qu'un taux suffisant est maintenu dans l'organisme malgré la dégradation des protéines transférées, ce qui rend cette méthode moins adaptée à des traitements très prolongés. La demi-vie des IgG étant approximativement de trois semaines, une sérothérapie anti-infectieuse n'est estimée efficace que 15 jours
Les anticorps ainsi transmis sont très efficaces dans les maladies où le rôle d'exotoxines diffusibles prédomine, diphtérie ou tétanos par exemple. La sérothérapie peut être utilisée à titre préventif, chez des sujets contacts, ou en principe à titre curatif lorsque la maladie estdéclarée. En fait l'antigénicité des sérums animaux, même s'ils sont purifiés ou employés sous forme de gammaglobulines, risque d'induire chez le receveur des manifestations d'hypersensibilité (anaphylaxie, maladie sérique). De ce fait l'emploi du sérum de cheval (notamment dans la prévention du tétanos chez les sujets non vaccinés) est en recul au profit des gammaglobulines humaines spécifiques. La sérothérapie à titre curatif n'est plus employée dans le tétanos.
On désigne sous le nom de gammaglobulines humaines
une préparation injectable riche en anticorps, préparée par fractionnement du
plasma sanguin. Ce terme, par analogie avec la fraction gammaglobulinique
identifiée lors de l'électrophorèse de zone du sérum, traduit l'état des
connaissances sur la chimie des protéines aux alentours des années 40. Depuis,
le terme d'immunoglobuline a été créé pour désigner la totalité des molécules à
fonction anticorps, et cette dénomination, plus précise, est employée
couramment actuellement. Aussi peut-on dire que les préparations étiquetées
"gammaglobulines" contiennent principalement des immunoglobulines,
mais elles peuvent ne pas contenir la totalité des immunoglobulines du sérum,
certaines variétés moléculaires n'ayant pas été retenues au cours de la
préparation.
1 - Différents types de gammaglobulines
a) Les gammaglobulines standard ou polyvalentes :
Elles ont deux origines : le sérum de donneur (CNTS) et les placentas après essorage (Industrie pharmaceutique). Le fractionnement de pools de plasmas provenant de nombreux donneurs permet d'avoir un très riche éventail de spécificités anticorps. Ces préparations sont dosées à 16,5g p. 100ml, ce qui correspond à environ 16 fois la concentration du plasma normal. Elles doivent être administrées en I.M.; en effet, l'emploi des préparations standard en I.V. peut déclencher un choc grave par activation du complément.
b) Les gammaglobulines spécifiques
Elle proviennent de donneurs spécialement hyperimmunisés (tétanos) ou de convalescents (maladies virales). Elles sont donc particulièrement riches en anticorps spécifiques, mais ces produits restent rares en raison de la difficulté de se procurer les plasmas nécessaires à leurs préparations. Ils ne doivent donc être utilisés qu'à bon escient. Ils sont préparés par le CNTS.
c) La fraction IGAM
Elle est préparée de façon à être riche en IgA et IgM, et possède un spectre anti-bactérien plus large notamment en ce qui concerne les Gram négatifs.
- Pour les cas très graves, des préparations d'immunoglobulines destinées à l'injection intra-veineuse peuvent être obtenues. Elles ont été traitées par la pepsine de façon à diminuer le risque d'activation du complément génératrice de choc.
2 - Les indications des gammaglobulines
Elles peuvent viser :
a) Un effet substitutif
Dans les déficits immunitaires; les déficits de la lignée B représentent l'indication la plus indiscutable des gammaglobulines. Dans les agammaglobulinémies ou hypogammaglobulinémies globales, congénitales ou acquises, la répétition d'injections de 0,6ml (environ 100mg) par kg assure généralement une protection satisfaisante.L'intervalle moyen des injections est de 2 à 3 semaines. En cas d'infection grave, les Ig polyvalentes intra-veineuses peuvent être utiles. Le déficit sélectif en IgA est en revanche une contre-indication à l'emploi de gammaglobulines, en raison du risque de sensibilisation anaphylactique.
b) Un effet préventif :
- dans les maladies virales, éruptives, les gammaglobulines polyvalentes sont efficaces si elles sont injectées à titre préventif dans des collectivités exposées, ou même immédiatement après le contact infectant. Chez les immunodéprimés (transplantés, leucémiques, corticothérapies) la protection contre le virus varicelle zona est réalisée par l'emploi d'Ig spécifiques. La prévention de l'hépatite A peut être obtenue par les Ig standard. Il existe des Ig spécifiques anti-HBS.
- Dans les maladies microbiennes, c'est surtout la prévention du tétanos qui est réalisée par des Ig spécifiques. Une vaccination correcte devrait en réduire les indications.
C) Un effet curatif :
L'effet favorable d'injections de gammaglobulines dans les maladies virales est plus difficile à apprécier. Dans les formes sévères, les immunoglobulines polyvalentes ou spécifiques semblent apporter une atténuation. Les infections par le virus varicelle-zona chez les immunodéprimés sont une bone indicaton des gamma-globulines spécifiques de ces infections. L'utilisation de gammaglobulines standard dans la prévention des infections banales récidivantes pulmonaires ou ORL en l'absence de déficit en Ig, ou chez les atopiques est une technique classique dont il est difficile d'apprécier les avantages réels.
B
- Vaccination:
1-
Définition:
Originairement développé en Inde et en Chine, puis au XVIIème siècle (Jenner), le principe de la vaccination a préexisté à l'invention de l'immunologie au XIXème siècle (Pasteur). La vaccination anti-infectieuse a pour but de susciter chez un individu non immunisé, une réaction immunitaire adaptative spécifique et durable contre un agent infectieux déterminé. Pour que la vaccination soit un succès, il faut que la réponse immunitaire induite protège le sujet vacciné contre une agression ultérieure par l'agent infectieux. Il faut aussi que le vaccination soit dépourvue de tout risque morbide.
Le développement d'un nouveau vaccin demande de longues années de mise au point in vitro, puis in vivo chez différentes espèces animales, et enfin chez l'homme. L'expérimentation clinique se fait en trois phases:
- phase I: étude de la tolérance chez sdes sujets non exposés au risque.
- phase II: étude de l'efficacité grâce à l'infection expérimentale de volontaires. Cette phase n'est bien entendu possible que lorsue la maladie est bénigne et aisément curable.
- phase III: étude de l'efficacité dans une population exposée à un risque endémique. Cette étape est très longue car elle nécessite l'étude de nombreux cas pour générer des données statistiquement exploitables.
2-
Les vaccins traditionnels
a)
vaccins contre les virus:
Pour susciter une réaction immunitaire spécifique, les vaccins traditionnels sont constitués de particules virales "atténuées", ou "inactivées" de façon à limiter au maximum le risque infectieux engendré par le vaccin. Plus récemment, ont été introduits des vaccins constitués seulrmrnt de "subunités" des particules virales totalement dépourvues de pouvoir pathogène infectieux (cf Tableau 1).
L'atténuation
des virus s'obtient de plusieurs façons:
- par passages successifs sur des cultures cellulaires (ex: rougeole, polio oral, fièvre jaune),
- en cultiant le virus dans les cellules d'un hôte inhabituel (ex: virus para-influenza de type B),
- production de souches sensibles à une température >37°C (ex: virus influenza A et B),
- production de souches virales ayant subi la délétion ou la mutation de certains gènes conditionnant la pathogénicité (ex: rougeole, oreillons, rubéole). Ces vaccins procurent une immunité durable et garantissent en principe une innocuité parfaite, mais on se heurte parfois à une certaine instabilité génétique des souches.
Les vaccins inactivés les plus fréquemment utilisés sont ceux contre la polio (sous-cutané), la rage et la grippe.L'inactivation est obtenue, par exemple, par traitement par la formaldéhyde.
Le premier vaccin sous forme de subunité a permis de protéger contre l'hépatite B: il n'était pas constitué de la totalité du virus, mais seulement de l'Ag de membrane HbS. Les subunités constitutives des vaccins représentent les épitopes reconnus par les lymphocytes B ou T du sujet vacciné. Ce sont actuellement des protéines recombinantes poroduites dans des gènes clonés das des bactéries comme Escherichia coli.
b) vaccins contre les bactéries:
Le
BCG est l'exemple type de vaccin constitué de bactéries atténuées par
repiquages successifs sur des milieux défavorables à la bactérie.
Les procédés classiques d'inactivation des bactéries recourent à des agents physiques ou chimiques. Des procédés d'inactivation par mutagénèse dirigée sont en cours de mise au point.
Les anatoxines, obtenues par inactivation des toxines par le formol, ne sont pas seulement utilisées pour vacciner contre les germes qui les produisent. Elles peuvent aussi servir de protéines porteuses pour des subunités vaccinales, généralement des polysaccharides constitutives de la capsule d'autres bactéries. Ces conjugués sont généralement très immunogéniques.
3-
Modes d'action des vaccins
Le but est d'obtenir une réaction immunitaire:
- spécifique (mettant en jeu les lymphocytes T effecteurs, T cytotoxiques, et les lymphocytes B).
- rapide
- prolongée (la rapidité et la durée prolongée mettent en jeu les lymphocytes mémoire; cette mémoire est obtenue grâce à la persistence de l'antigène vaccinant dans les centres germinatifs sous la forme d' "iccosomes", "immune complex coated bodies").
- protectrice, empêchant la survenue de la maladie lors d'un contact ultérieur du sujet avec le germe infectieux contre lequel il a été vacciné.
a)
les anticorps:
Ils reconnaissent surtout des épitopes conformationels sur les antigènes vaccinants. Ils agissent:
- en neutralisant l'infectivité des bactéries et virus. Au niveau des muqueuses, la combinaison avec des IgM ou des IgA sécrétoires spécifiques modifie la configuration stéréo-chimique des molécules de membranes qui permettent à l'agent de se fixer sur le récepteur cellulaire qui lui permet d'infecter les tissus.
- en lysant les bactéries ou les virus en présence de complément (ceci n'est vrai que pour les IgM et les IgG capables d'activer le complément).
- en favorisant l'opsonisation, en présence du complément
- en limitant la réplication après internalisation.
Les anticorps peuvet aussi intervenir par l'intermédiaire de la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC). Ce mécanisme est souvent mis en jeu dans la défense contre les agents parasitaires.
La production d'anticorps spécifiques après vaccination se fait par dosage des immunoglobulines sériques spécifiques (ELISA, néphélométrie par exemple). Lors de la première injection, ce sont des IgM qui sont produites. Leur concentration est modérée et le pic, transitoire (réaction primaire). Les injections suivantes et surtout les injections de rappel ont pour but de faire produire des IgG (réaction secondaire) à un taux élevé et durable (lymphocytes B " mémoire "). Le nombre de cellules B productrices de ces anticorps peut être évalué par ELISPOT.
b)
les lymphocytes T:
Les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ sont utiles pour lutter contre les infections par des germes à développement intra-cellulaire.
Les antigènes des préparations vaccinales constituées de germes tués ou de subunités sont présentées par les HLA de classe II des CPA, stimulent les lymphocytes T auxiliaires et génèrent des clones T cytotoxiques et des clones B. Les vaccins viraux atténués se répliquent dans les cellules. Leurs protéines sont présentées par les HLA de classe I aux clones T cytotoxiques générés.
Le mode de préparation du vaccin doit pouvoir orienter la réponse vers un profil TH1 si l'on veut surtout susciter une réponse T cytotoxique; ou vers ue réponse TH2 si l'on veut obtenir une réponse préférentiellement humorale.
c) les adjuvants:
L'emploi d'adjuvants en association avec les protéines vaccinantes a pour but d'amplifier la réponse immunitaire spécifique. La substance la plus utilisée en clinique, depuis 50 ans, est l'alun. En expérimentation animale, l'adjuvant le plus efficace est l'adjuvant complet (suspension oléo-aqueuse de mycobactéries tuées) ou incomplet (suspension aqueuse) de Freund. La subunité active dans l'adjuvant de Freund est la N-acétyl-muramyl-L-alabnine-D-isoglutamine ou MDP. L' adjuvant de Freund n'est pas employé chez l'homme.
Les adjuvants entraînent une activation des cellules présentatrices d'antigènes qui accroît la stimulation des lymphocytes T. Ils permettent de pièger plus longtemps les antigènes vaccinants dans les organes lymphoïdes secondaires.
De nouveaux adjuvants sont maintenant utilisés ou en cours de mise au point:
- les ISCOMS, où les antigènes sont emprisonnés dans une cage de 40 m de diamètre composée d'un dérivé de la saponine. Ils augmentent la réponse anticorps et la production de lymphocytes T cytotoxiques dans certains cas.
- des liposomes peuvet servir de vecteurs à l'antigène et stimuler puissamment les CPA. Les liposomes eux-mêmes peuvent être combinés à l'alun.
- on peut fabriquer aussi des microcapsules
4-
Les nouveaux vaccins
a) composition:
- les subunités: l'utilisation de subunités supprime tout risque pathogène direct dû à l'agent infectieux. Un risque persiste cependant: celui de susciter une réaction auto-immune en injectant un déterminant antigénique croisé avec un auto-atigène du receveur. La subunité doit comporter des épitopes du germe reconnus par les lymphocytes T et B des sujets vaccinés. Ces épitopes doivent être au préalable définis, puis synthétisés. Actuellement la synthèse se fait par biologie moléculaire, après transfection dans des levures ou dans des lignées cellulaires.
La liaison covalente des peptides obtenus avec une chaîne lipidique (tripalmitoyl-glycéryl-cystéinyl-seryl-sérine) permet la formation de lipopeptides particulièrement eficaces dans la génération de lipopeptides.
On peut aussi envisager de combiner la subunité à un anticorps monoclonal spécifique d'une région monomorphe d'une molécule HLA de classe II vers laquelle il guidera l'antigène vaccinal pour une présetation plus efficace.
- on peut induire l'apparition d' anticorps spécifiques d'un antigène X en déséquilibrant le réseau idiotypique de façon à susciter l'apparition d'anticorps anti-idiotypiques portant l'image interne de l'antigène X (Fig. 1):
Figure 1: A: Production in vitro ou chez l'animal d'un Ac2 porteur de l'image interne d'un Ag X; B: injection de l'Ac2 pour induire la production de l'Ac1 protecteur. Ce mode de vaccination n'implique donc pasl'injection de l'antigène vaccinal. Il est utile queand l'antigène n'est pas disponible ou toxique.
- on peut aussi enisager l'injection de vecteurs vivants bactériens ou viraux, transfectés avec l'ADN codant l'antigène vaccinal qu'il synthétise et délivre au sein de l'organisme du sujet vacciné; bien entendu les agents vecteurs sont atténués, mais le risque pathogène dû au vecteur n'est pas toujours nul.
Tableau 3: Agents infectieux proposés comme vecteurs d'ADN vaccinal:
- Il s'est avéré récemment que l'injection intra-musculaire d'ADN nu suffisait dans certains cas à entraîner une véritable vaccination contre la protéine codée par l'ADN et synthétisée par les myocytes qui l'incorporent. Pusieurs vaccins de ce type sont en cours de mise au point.
b) voie d'administration:
La plupart des vaccins ont été jusqu'ici administrés par voie générale, sous-cutanée ou itra-musculaire. Plus récemment, avec le vaccin anti-poliomyélitique atténué, a été introduite la vacination par oie orale.
En fait, la plupart des infections sont contractées par voie muqueuse, puisque les muqueuses représentent chez l'adulte une interface très étendue (superficie d'un court de tennis) entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. La vaccination par voie générale crée une barrière immunologique en aval de l'infection muqueuse (Ac sériques et lymphocytes T). Il serait logiue d'induire une immunité muqueuse qui agisse en amont de la vaccination systémique et qui empêche la pénétration des germes dans le milieu intérieur. De nombreux futurs vaccins auront pour cobles les cellules tissus lymphoïdes des voies digestives, respiratoires et génitales.
c)
autres utilisations des vaccins
Tout d'abord, dans le cadre de la défense contre l'infection, il est possible que les nouveaux vaccins n'aient pas seulement une action préventive, mais aussi une action curative en entraînant une réaction immunitaire suffisamment puissante pour éradiquer les germes au cours d'infections chroniques.
Des thérapeutiques vaccinales à visée curative pourront être aussi développées pour des maladies auto-immunes. La manipulation du réseau idiotypique (cf Fig. 1) serait appropriée dans les cas où l'auto-antigène est inconnu.
Une vaccination contre les antigènes tumoraux peut aussi être envisagée pour le traitement de certaines tumeurs dont les antigènes sont connus.
4- Conclusions
En conclusion, les critères immunologiques d'un bon vaccin sont les suivants:
- stimulation des CPA pour une présentation efficace des antigènes et création d'un environnement cytokinique favorable à la stimulation des lymphocytes.
- activation des lymphocytes T et B avec génération intense de cellules "mémoire".
- génération de TCD4+ et TCD8+ reconnaissant des déterminants variés à la surface du germe infectant, pour que la réponse vaccinale ne soit pas variable avec le phénotype HLA des sujets vaccinés (selon le phénotype des antigènes de classe II en particulier, la présentation de tel ou tel déterminant peut être plus ou moins efficace).
- persistance de l'antigène vaccinant sous forme native à la surface des cellules folliculaires dendritiques dans les tissus lymphoïdes périphériques où se recrutent les cellules B "mémoire", assurant la maturation de l'affinité et la présence durable d'anticorps spécifiques.
- l'apparition d'anticorps spécifiques ("séro-conversion") doit être constatée chez 100 % des sujets vaccinés.
II - Traitements immunodépresseurs
Etant donné le rôle du système immunitaire dans le déterminisme de nombreuses affections en apparence primitives et dans le rejet des greffes, il est logique de tenter de freiner de manière aussi sélective que possible la réaction immunitaire :
- au cours des maladies auto-immunes;
- après une greffe ou une transplantation.
Le développement de la réponse immunitaire est associée à une explosion de mitoses dans le système lymphoïde. Les médicaments immunodépresseurs sont donc choisis essentiellement en fonction de leur aptitude à inhiber la multiplication des cellules lymphoïdes. Malheureusement le pouvoir cytotoxique des médicaments utilisés n'est pas sélectif et ne touche pas uniquement les lignées lymphoïdes, mais toute lignée cellulaire en cours de prolifération active. Cette activité cytotoxique explique l'emploi des mêmes médicaments immunodépresseurs dans le traitement des cancers. Les caractéristiques du traitement immunodépresseur idéal seraient les suivantes :
1) Large marge de sécurité entre dose toxique et dose thérapeutique.
2) Absence d'action sur les autres lignées et notamment des lignées rouges.
3) Action aussi sélective que possible sur les lignées impliquées dans la réaction immunologique.
4) Possibilité d'administration limitée dans le temps
5) Activité sur des processus immunitaires déjà établis (effet curatif).
Il va sans dire qu'aucun traitement immunodépresseur ne remplit actuellement ces critères.
A
- Les traitements utilisés
1-
Les corticoïdes
Ils sont susceptibles d'être employés dans la plupart des maladies mettant en jeu le système immunitaire: cependant leur action immunodépressive proprement dite est faible. Chez certains animaux on peut obtenir une diminution des réponses anticorps ou déprimer la réponse à la tuberculine, mais ceci ne paraît pas s'observer chez l'homme, même aux doses les plus fortes que l'on peut utiliser en thérapeutique. Dans le LED et dans d'autres connectivites (polyarthrite rhumatoîde) en poussée, on a parfois recours à la "pulse" thérapie (ou "bolus") qui consiste à injecter à 3 reprises par voie intra-veineuse 1g d'un corticoïde soluble (methylprednisolone, ou Solumedrol ).
2-
Les agents physiques
L'action anti-mitotique des rayons X a été la première utilisée mais actuellement elle est remplacée par l'emploi de substances chimiques. En effet, une immunodépression efficace nécessite une irradiation totale de l'organisme. Expérimentalement, celle-ci est active surtout sur la réponse primaire, lorsque la stimulation antigénique a lieu 48 heures après l'irradiation. La réponse secondaire est beaucoup moins influencée. La suppression de l'hypersensibilité cellulaire nécessite des doses de radiations beaucoup plus importantes que celles de l'hypersensibilité humorale.
Les rayons X agissent sur deux cibles:
- inhibition des mitoses, en produisant des lésions des chaines d'acide nucléique;
- diminution de l'activité des macrophages qui jouent un rôle dans le traitement de l'information antigénique.
3-
Les agents alkylants
Ils sont susceptibles de modifier à la fois l'ADN et les protéines : ils bloquent la mitose en modifiant l'hélice d'AN et en outre, semblent avoir un effet inhibiteur et destructeur sur certains enzymes réduisant ainsi l'inflammation périphérique. La moutarde azotée est le plus simple des composants alkylants.
Le cyclophosphamide (Endoxan) est plus utilisé actuellement car mieux toléré. Après introduction dans l'organisme, il est en effet scindé en plusieurs dérivés, dont une molécule de moutarde azotée. Il semble agir surtout sur les cellules de la lignée B. L' Endoxan est généralement employé par voie buccale en traitement prolongé dans ces indications ; cependant on pratique parfois des injections i.v. espacées de très fortes doses (bolus ),par exemple en néphrologie.Le chloraminophène appartient à la même classe de médicaments.
4-
Anti-métabolites analogues des bases puriques et pyrimidiques
Ils se substituent aux composants normaux dans les molécules d'ADN ou d'ARN. La 6 mercapto-purine est un anti-métabolite de la guanine. Elle tend de plus en plus à être remplacée dans le traitement immunodépresseur par l'azathioprine (Imurel), dérivé mieux absorbé que la 6 M.P. In vivo, l'azathioprine est transformée en 6 M.P., vraisemblablement au niveau du foie. L'azathioprine semble être, à effets égaux, une des substances les mieux tolérées. Le 5 fluoro-uracile et la 5 bromodésoxyrudine sont des antagonistes des pyrimidines.
5-
Inhibiteur d'enzymes dans le métabolisme de l'acide folique
L'améthoptérine (Méthotrexate) est un anti-métabolite de l'acide folique qui agit en fait par fixation sur la réductase folique et empêche la conversion de l'acide dihydrofolinique en acide tétrahydrofolinique : ce dernier est indispensable à la formation de thymidine, nécessaire à la synthèse de l'ADN. Le Méthotrexate peut exercer une action dépressive sur les lignées hématopoiétiques. Il peut avoir une toxicité hépatique (fibrose) d'où la nécessité de controler mensuellement la fonction hépatique.
6-
La Cyclosporine
Elle a transformé le pronostic des transplantations d'organes et est utilisée dans différentes maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoide.Cette bloque la synthèse d'IL2. Une certaine toxicité pouant entraîer une insuffisance rénale et une hypertension artérielle red écessaire une surveillance très stricte afin d'arrêter le traitement dès les premiers signes d'intolérance.Une hyperplasie gingivale,une hypertrichose sont souvent observées.La posologie doit être adaptée en fonction du dosage du médicament dans le plasma.
Un autre médicament, ayant aussi ue toxicité rénale, le FK506 agit comme la cyclosoporine, sur la production d'Il-2, par un mécanisme différent.
7-
Autres médicaments
De nouveaux médicaments immuno-suppresseurs, agissant plutôt sur la lignée B sont actuellement en expérimentation: le mycophénolate mofétil, le léflunomide, ainsi que la 15-désoxysperguanine.
8-Le
sérum anti-lymphocyte
Cette thérapeutique apparaît théoriquement comme beaucoup plus séduisante que toutes les précédentes puisqu'elle utilise une méthode immunologique pour supprimer spécifiquement l'action des lymphocytes. Le SAL est obtenu par immunisation du cheval avec des lymphocytes humains et après séparation des IgG, et élimination des anticorps d'autre spécificité.
Son activité est prouvée par l'expérimentation : il est particulièrement actif sur l'immunité cellulaire. Cependant, en pratique le sérum anti-lymphocytaire reste peu utilisé en dehors des transplantations, et notamment des transplantations rénales.
9-
Les anticorps monoclonaux
Certains anticorps monoclonaux permettent de mieux cibler l'effet immunodépresseur que le sérum anti-lymphocyte dont la spécificité est très large. Ainsi, l'emploi de monoclonaux anti-CD3 permet de toucher exclusievement les lymphocytes T du malade. Ce traitement est utilisé notamment dans le traitement curatif des rejet aigus de greffes allogéniques.
D'autres monoclonaux, anti-CD4, spécifiques de molécules d'adhésion comme LFA-1 ou spécifiques de cytokines comme le THNF ou l'IL-1 sont encore à l'étude.
B
- Points d'impact de l'immunodépression
Ils sont multiples. Chaque substance semble en fait agir à la fois sur les mécanismes centraux et périphériques, si bien que l'atténuation de la réaction immunitaire est complétée par une action dépressive sur les mécanismes inflammatoires. L'intensité relative de ces divers effets varie suivant les types de produits. En outre, les différentes lignées sont atteintes inégalement; c'est ainsi que l'Endoxan agit plutôt sur les cellules B alors que l'azathioprine, la cyclosporine et le FK506 agissent sur les cellules T.
Les agents alkylants tels que le cyclophosphamide agissent à un stade précoce de la réponse immunitaire probablement par effet cytolytique. Expérimentalement, ils doivent être administrés avant la stimulation antigénique, ce qui montre qu'ils agissent au niveau de la captation des antigènes et des premières divisions de cellules immunocompétentes. Cependant, l'action du cyclophosphamide dans des processus déjà établis montre qu'il agit aussi à un stade périphérique. C'est ainsi que dans les anémies hémolytiques auto-immunes, il freine la capture des hématies chargées d'anticorps par les cellules du système des phagocytes mononucléés.
Les anti-métabolites sont principalement actifs sur la réaction immunitaire mais à des stades différents : la 6 M.P. bloque la différenciation des lymphocytes ou immunoblastes, alors que le méthotrexate n'empêche pas cette différenciation, mais la division des immunoblastes. Toutes ces substances ont encore un rôle dépresseur sur la réaction au niveau périphérique.
La cyclosporine et le FK506 inhibent la synthèse de l'IL-2 et bloquent ainsi l'activation des lymphocytes T
C)
Dangers des immunodépresseurs
1-
Un traitement corticoïde prolongé fera redouter:
- une infection, notamment tuberculeuse ou virale,
- l'ostéoporose ,
- l'osteonécrose aseptique de la tête fémorale
- des modifications morphologiques de type Cushing
- des troubles de la glycorégulation
- des complications ulcéreuses gastriques
- des troubles de la croissance chez l'enfant
- une insuffisance surrénale à l'arrêt du traitement
2- Les
immuno-dépresseurs autres que les corticoïdes représentent des risques tels
qu'il faut réserver leur emploi aux maladies qui menacent la vie du malade
- toxicité hématologique:
Ce sont surtout les agents alkylants et les anti-métabolites qui sont responsables des anémies, des leucopénies, des aplasies médullaires. Ce danger doit toujours être redouté et les malades doivent être soumis à des vérifications très fréquentes de la N.F.S., même lors des traitements d'entretien (chaque semaine).
- risque infectieux: Il s'explique par l'association de plusieurs facteurs :
- diminution de la réaction immunitaire à anticorps circulants et de l'immunité cellulaire;
- réduction de l'activité des macrophages;
- baisse du nombre des polynucléaires.
Il en résulte la gravité et la fréquence des affections microbiennes, et la possible survenue d'affections virales ou mycosiques graves et d'infections à germes opportunistes.
- risque de carcinogénèse: lymphomes, sarcomes type Kaposi, tumeurs cutanées et utérines. Ce risque peut paraître paradoxal puisque l'on emploie des substances réputées anti-cancéreuses. Ces tumeurs sont probablement induites par des virus dont la réplication est favorisée par le traitement immunodépresseur.
- risque de malformations fœtales:
Chez la femme jeune, il est souhaitable d'associer des mesures contraceptives pour éliminer le danger de malformations foetales en cas de grossesse.
- complications propres à chaque médicament:
Cf cours de pharmacologie. Il faut retenir principalement les cystites hémorragiques dues à l'Endoxan, l'HTA et l'insuffisance rénale due àla cyclosporine, et les atteintes hépatiques et pulmonaires du Méthotrexate.
III - Immunostimulation
Le traitement des déficits immunitaires est très complexe et encore mal codifié : les déficits immunitaires congénitaux et les déficits acquis dûs à des troubles patents des cellules effectrices sont avant tout justiciables d'un traitement substitutif (cf Ch 21 "Déficits immunitaires").
Il existe cependant actuellement des substances pharmacologiques de synthèse ou d'origine biologique, susceptibles de stimuler in vivo un système immunitaire défaillant, le plus souvent au cours d'affections malignes ou inflammatoires.
A
- Substances immunostimulantes
Les produits de synthèse qui ont été le plus souvent utilisés sont le levamisole et l'isoprinosine. Les produits d'origine biologique sont le BCG, le muramyl dipeptide (MDP), l'interféron (surtout l'interféron gamma d'origine lymphocytaire), les interleukines I et II et les facteurs thymiques. A vrai dire, tant au cours des cancers qu'au cours des maladies inflammatoires chroniques, ou des déficits acquis tels que le SIDA, on n'a pu démontrer l'efficacité d'aucune de ces substances pour restaurer le statut immunitaire des malades. Cependant, certaines d'entre elles sont encore en cours d'étude.
B
- Mécanismes hypothétiques des immunostimulants
L'immunostimulant idéal serait un médicament non toxique capable d'activer électivement une sous-population de cellules lymphoïdes, telle par exemple, que les cellules TH1 ou TH2 selon les beoins. Malheureusement à l'heure actuelle on ne dispose d'aucun médicament à action sélective et il semble que certaines au moins des substances utilisées soient capables aussi bien de freiner que de stimuler les lymphocytes selon les circonstances, de sorte que le résultat obtenu peut être aussi bien une dépression accrue qu'une stimulation de l'immunité, selon le statut immunitaire du patient au moment de l'administration du produit. La difficulté majeure réside dans l'ignorance où nous sommes souvent généralement du point d'impact in vivo des immunostimulants chez un malade à un moment donné.
IV- Les aphérèses
A
- Les plasmaphérèses
Certaines vascularites auto-immunes graves peuvent être autonomes (par exemple, maladie de Wegener, périartérite noueuse, cf chapitre sur les connectivites). Elles peuvent aussi compliquer un lupus érythémateux disséminé, une polyarthrite rhumatoïde ou un syndrome de Gougerot-Sjögren par exemple. Lorsqu'elles menacent la vie du malade en entraînant la défaillance d'un organe majeur comme le rein ou le cerveau, on peut recourir à la plasmaphérèse qui permet d'épurer les complexes immmuns circulants. Ces complexes sont généralement responsables de l'inflammation vasculaire et des lésions tissulaires, à cause de l'activation locale du complément qu'ils entraînent.
Les cellules du système des phagocytes mononucléés chargés d'épurer les immuns complexes peuvent se trouver débordées par l'hyperproduction de ces complexes au cours de ces connectivites et, victimes d'une sorte "d'indigestion" voient leur activité phagocytaire diminuer, ce qui crée un cercle vicieux aboutissant à un accroissement du taux de complexes circulants (cf chapitre sur le complément). La plasmaphérèse consiste à soustraire au malade environ 2 litres de plasma en lui restituant ses cellules sanguines triées extemporanément, avec un apport liquidien et protéique équivalent au volume soustrait..
Cette technique n'apporte pas la guérison, mais peut permettre de passer un cap de gravité, en attendant l'effet d'une thérapeutique immunosuppressive simultanément administrée, d'action plus lente. En plus de son coût et de sa lourdeur technique, elle n'est pas dépourvue de risques: accidents infectieux, mort subite qui en restreignent les indications .
B
- Les cytaphérèses
La
déplétion en lymphocytes, notamment en lymphocytes T par drainage du canal thoracique,
a donné des résultats positifs dans certaines PR graves. Cependant,
l'incommodité et les risques de l'installation d'une cannule de drainage ont
limité les études et les indications de cette technique.